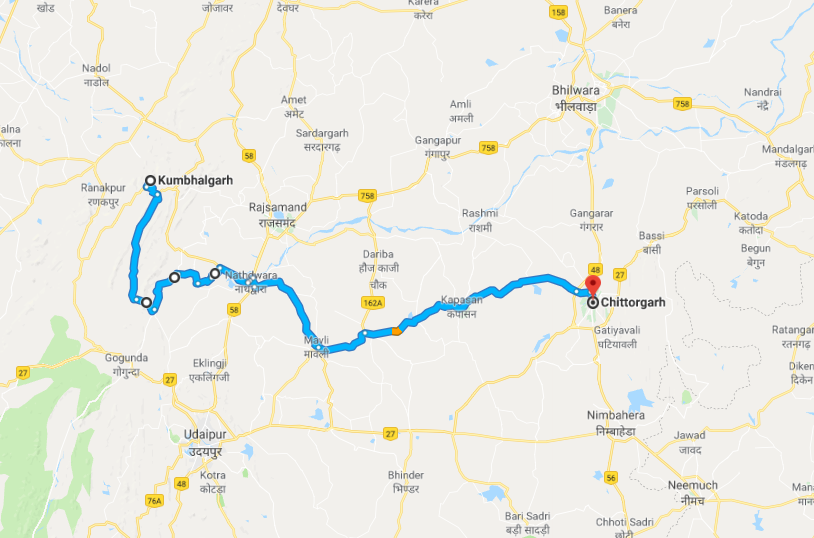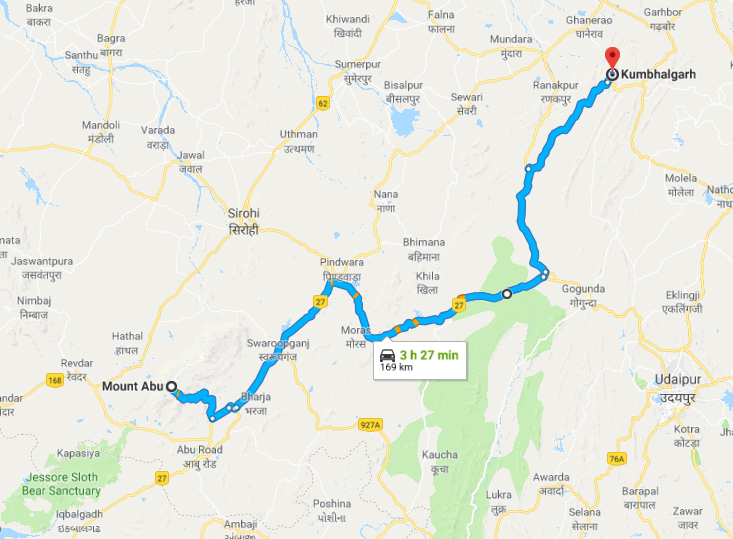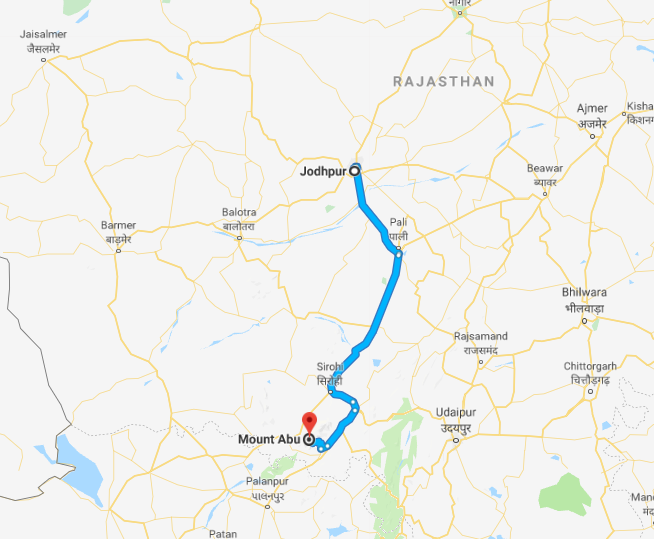- Date: 10 mars 2018
- Départ: 12h00
- Arrivée: 18h30
- Température: soleil puis nuage
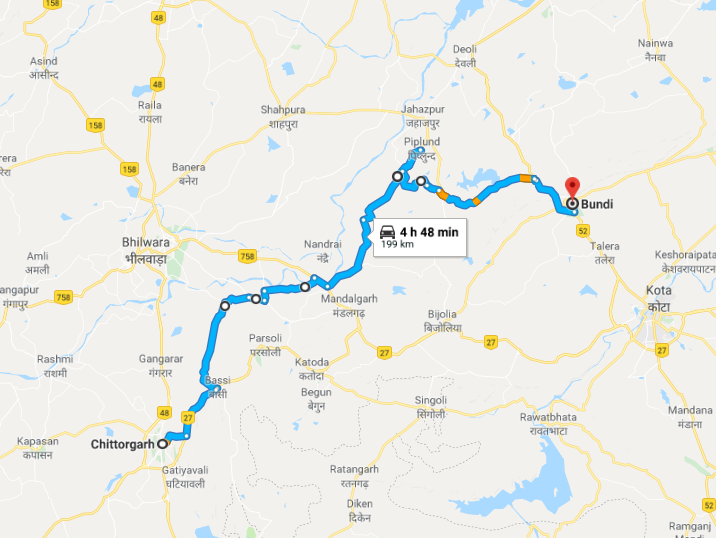


Grasse matinée bien méritée, alors nous avons quitté Chittorgarh plus tard qu’à l’habitude. À la sortie de la ville, nous sommes tombés sur une autoroute indienne plutôt banale, alors à la première occasion, nous avons bifurqué vers une route tertiaire. De qualité kazakhe (c’est à dire, défoncée), il nous a fallu un bon 3 heures pour parcourir le tiers de notre trajet. Encore une fois par contre, le détour en valait la peine; ces petits détours ne manquent jamais d’agrémenter notre journée et à chaque pause, Audrey et moi nous comptons ce que l’un ou l’autre a pu manquer au passage: as-tu vu le rassemblement d’hommes à turbans? la vache avec des immenses cornes? les gens en train de se laver dans la rivière? la procession de dames en saris toutes transportant des cruches d’eau sur leurs têtes? C’est étonnant à quel point l’Inde rurale est empreinte de traditions. Cependant, la coupure est flagrante: les gens de notre âge sont pour la plupart en jeans-chemise avec lunettes de soleil et téléphone intelligent (pour les hommes du moins). Désolé, pas trop de photos; s’arrêter en plein village nous expose à beaucoup trop d’attention, déjà que notre passage fait tourner pas mal toutes les têtes. De plus, les anciens sont généralement réticents à ce qu’on les prennent en photos. Les Indiens ne sont pas dupes (ils ont la télé quand même) et se rendent bien compte du fait qu’ils font partie de la tranche de population plus pauvre du pays.


De retour sur une route plus majeure, le pas s’est accéléré. Le paysage, toujours beau et intéressant. La Rajasthan a ceci de magique qu’à bien des endroits il conjure réellement des images de temps immémoriaux où divers souverains à la tête d’armées de cavaliers et de lanciers prenaient de siège d’imposants forts par soif de pouvoir ou par rétribution. Oubliez l’Europe médiévale, les histoires d’héroïsme chevaleresque, de batailles sanglantes et de conquêtes, c’est au Rajasthan qu’elles se déroulaient. De notre côté, tant de route, ça fait mal au cul. Les sièges de motos ne sont pas si mal que ça, mais au bout de quelques heures, la chaleur et les bosses finissent par sérieusement endolorir nos postérieurs.